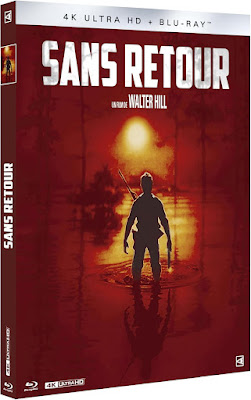Monsieur Aznavour : For me formidable biopic 17 Apr 6:07 AM (yesterday, 6:07 am)

Je ne sais pas si Grand Corps Malade et Mehdi Idir voyaient déjà Monsieur Aznavour en haut du box-office quand ils l'ont écrit puis réalisé. Leur film a en tout cas séduit le public, avec plus de deux millions d'entrées en salle. La géniale interprétation de Tahar Rahim y est évidemment pour quelque chose, mais pas seulement. La sortie en vidéo donne l'occasion de se (re)plonger dans un biopic réussi.
Aznavour la légende
Avec une telle icône de la culture française, le duo de réalisateurs a trouvé un sujet en or. Ses chansons sont fredonnées de Paris à Tokyo, en passant par New York et Erevan. Il a côtoyé les plus grandes stars de la deuxième moitié du XXe siècle. Son immense capital sympathie repose également sur une ouverture d'esprit, une tolérance et un engagement qui ont suscité l'admiration. Cet enfant d'immigrés arméniens a aussi connu un parcours hors normes, passant des quartiers populaires de Paris aux palaces du monde entier, traversant la guerre et surmontant quelques drames personnels avec une impressionnante force de caractère et quelques traits de personnalité un peu moins glorieux. Un incroyable destin qu'il ne restait plus qu'à condenser en près de 2h15.
GCM et Idir les conteurs
Les réalisateurs avaient obtenu l'aval de Charles himself. Lequel devait faire une apparition dans le film, avant que sa disparition marque un coup d'arrêt au projet. Passée la période du deuil, les enfants de l'artiste ont relancé l'idée du biopic, développé par son gendre Jean-Rachid Kallouche. Résultat : le film nous emporte dans un tourbillon de chansons et de séquences spectaculaires ou émouvantes. Bien sûr, certains tubes n'ont été utilisés que pour le générique de fin (en même temps, difficile de tout caser avec une telle discographie). On regrette aussi que la carrière cinématographique de l'artiste soit rapidement survolée. Et que la face B de sa personnalité soit montrée sans trop d'insistance. Reste que le plaisir est total. Décors, costumes, effets spéciaux contribuent à nous replonger dans plus d'un demi-siècle d'Histoire. La photo de Brecht Goyvaerts est belle, la mise en scène portée par de jolies trouvailles qui permettent au film d'échapper à l'écueil du classicisme.
Rahim le magicien
Evidemment, la prestation de Tahar Rahim est monumentale. Critiques et spectateurs l'ont encensé, avec raison. Alors que le choix du comédien n'avait rien d'évident, il s'est approprié la voix du chanteur (au point d'interpréter lui-même les chansons), sa gestuelle, ses expressions physiques comme verbales. Dès son apparition à l'écran, Rahim fait oublier le vrai Aznavour. Car Aznavour, c'est lui. On y croit. Et on s'attache à ce petit homme qui veut devenir grand, à force de détermination sans failles, de travail acharné, de filouteries et de trahisons aussi. Ses joies deviennent les nôtres, ses chagrins nous cueillent en plein coeur. Quelle interprétation ! Au-delà de la technique et du jeu, Tahar Rahim a su si bien entrer dans la peau de son personnage, certainement parce qu'il partage avec lui une double culture, du talent et de l'intuition, et une impressionnante éthique de travail.
De la même manière qu'Aznavour a su partager l'affiche avec d'autres partenaires tout aussi doués, Rahim ne cannibalise pas le film. Sa performance n'occulte pas celles de ses compagnons de jeu. Marie-Julie Baup s'affranchit de l'ombre de Marion Cotillard pour camper une Edith Piaf gouailleuse et marrante. Gouaille encore avec Bastien Bouillon, lumineux copain de Charles au début de sa carrière. J'ai aussi beaucoup aimé la solide interprétation de Camille Moutawakil, qui prête ses traits et son visage (qui évoque parfois celui de Lady Gaga) à la soeur du chanteur.
J'aurais bien aimé que le générique de fin associe Aznavour et Rahim dans une interprétation de Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Peut-être que les réalisateurs y ont pensé mais que Rahim a pudiquement refusé. C'est ce que je veux croire mais cela aurait eu de la gueule.
En bonus de cette édition Pathé, une masterclass au cours de laquelle Grand Corps Malade, Mehdi Idir et Tahar Rahim reviennent sur les tribulations du projet, sa production et le défi pour le comédien d'incarner le chanteur, d'en interpréter les chansons en live pendant le tournage... puis de les réenregistrer plus tard en studio.
Anderton
BD - La survie des naufragés de l'espace 13 Apr 3:03 AM (5 days ago)

Décidément, les robinsonnades sont à l'honneur au rayon bande dessinée. Après Il déserte (Dargaud), album dans lequel Antoine de Caunes revient sur une fugue paternelle, place à Corso (Soleil) et Si vous lisez ça je suis déjà morte (Delcourt). Cette fois-ci, deux protagonistes se retrouvent perdus sur des planètes hostiles.
Matt Kindt, Dan McDaid et Bill Crabtree : Si vous lisez ça je suis déjà morte (Delcourt)
Tout commence comme dans Aliens ou Predator. Un commando de militaires se rend sur une planète où les humains ont installé un camp retranché. Robin, une journaliste, les accompagne. A peine arrivés dans cette "zone verte", le groupe est attaqué par des créatures armées. Seuls la journaliste et un soldat échappent à la mort en se réfugiant dans un souterrain qui les mène dans une cité étrange. Les créatures armées y oppressent un autre peuple. Et traquent le duo de survivants.
Derrière ce titre intrigant, les auteurs livrent un récit original qui mêle science-fiction, aventure et horreur. Outre celles des deux films précités, les influences de John Carter et de Lovecraft se font sentir au fil des pages. Pas de temps mort. Robin tente de sauver sa peau au sein d'un monde cauchemardesque. Elle rappelle que les femmes paumées dans l'espace sont souvent badass.
Danilo Beyruth : Corso (Soleil)
A la suite d'un combat dans l'espace, le vaisseau de Corso s'écrase sur une planète a priori désertique. Soldat indiscipliné de la République des chiens, il est animé d'une rage qui booste son instinct de survie. Contraint d'errer dans le désert, il découvre bientôt un autre environnement, luxuriant, peuplé de monstres. Et tombe sur un mystérieux chasseur masqué, qu'il sauve de la mort.
L'auteur tient les lecteurs en haleine tout au long du récit. Comme il se doit, cette planète inconnue regorge de dangers et de surprises que Corso affronte avec détermination. Le personnage est attachant, ses blessures psychologiques sont rappelées lors de flashbacks, tandis qu'il apprend à découvrir un peuple a priori inamical. Pour le coup, ici, ce sont les films sur la guerre du Vietnam ou les westerns se déroulant au sein d'une communauté indienne qui nous viennent à l'esprit. Danilo Beyruth fait délicatement souffler dans sa BD un message de tolérance et de paix, sans jamais alourdir l'aventure qu'il fait vivre à son héros.
Anderton
Zion : course-poursuite au coeur de Gwada 8 Apr 12:24 AM (10 days ago)

La promesse de Zion était alléchante. Un film "100 % antillais" qui bénéficie d'une sortie nationale. Mieux encore, le réalisateur Nelson Foix a réalisé un thriller qui embarque un bébé au milieu d'un trafic de drogue et nous donne à voir une Guadeloupe bien éloignée des cartes postales. C'est pas doudou, c'est du-dur ! An bèl réyisit !
Au coeur d'une cité de Pointe-à-Pitre, Chris vivote entre petits trafics de drogue, coups d'un soir et rodéos à moto. Jusqu'au jour où Odell, le dealer local, lui propose de gagner une belle bécane en échange d'une double livraison de drogue en quelques heures. L'occasion est trop belle. Chris accepte. Mais en rentrant chez lui, il découvre devant sa porte un grand sac de course. A l'intérieur, un bébé et un message : "Timoun aw" (Ton enfant). Impossible d'annuler le contrat ! Chris tente bien de confier l'enfant à une amie, sans succès. Il enfourche donc sa moto, avec la came et le bébé dans le sac. Une mauvaise idée, rien ne va évidemment se passer comme prévu.
Dès la séquence d'intro, le spectateur sait qu'il a affaire à un réalisateur qui a des choses à raconter et qui a décidé de le faire avec une vision bien à lui. C'est pourtant son premier film, adapté de son propre court-métrage (Timoun aw), avec l'aide notamment de Jamel Debbouze. On est tout de suite emporté par le récit. La Guadeloupe de Zion n'est ni celle des guides touristiques, ni celle des beaux quartiers. Plongée au coeur des cités antillaises, où règnent comme en métropole la violence, la débrouille et le désoeuvrement.
Dans le rôle de Chris, Sloan Decombes est la gars (presque) ordinaire projeté dans une situation extraordinaire. Il fait passer toutes les émotions d'un personnage qui nous apparaît d'emblée égoïste et irresponsable avant qu'il développe une affection de plus en plus forte pour ce bambin, dont il refuse d'abord la paternité. Souvent dépassé, il n'en est pas moins malin et bientôt déterminé. Pour que le film soit réussi, il fallait que cet anti-héros soit attachant et c'est le cas. Les galères s'enchaînent et on s'inquiète avec lui.
De Carib en shatta
Au cours de la folle odyssée de Chris, Nelson Foix nous fait découvrir l'état de son île. Rien de misérabiliste. Juste un regard sans fard sur une société qui a perdu ses repères. Il y a encore quelques fragiles passerelles au-dessus du fossé qui se creusent entre les générations, celle des "adultes" qui tentent de faire vivre la culture "péyi" et celle des jeunes qui vivent chaque journée comme si c'était la dernière, entre shatta (le dancehall local) et weed.
Le réalisateur déroule un récit tendu, ponctué de rebondissements, pétarades de moto, gwo ka (tambours traditionnels) et coups de feu. Et sans baisser d'un cran, sans appuyer son message, il nous donne à partager le quotidien de nos compatriotes antillais. Coût de la vie intenable, volonté de vivre dignement et pour certains en s'affranchissant d'une République ingrate. Une dure réalité qui n'empêche pas le surgissement de séquences oniriques. La séquence finale est formidable. Nelson Foix signe un hommage vibrant à son île et ses habitants. Et on vibre avec lui.
Anderton
La robinsonnade de papa de Caunes 28 Mar 1:00 AM (21 days ago)

Avec Il déserte, publié chez Dargaud, Antoine de Caunes n'a pas seulement trouvé un beau titre pour son premier album de BD, il a cosigné un récit émouvant sur une fugue paternelle, que Xavier Coste a sublimement illustré.
Il a fallu du temps au fils pour se livrer sur l'escapade de son papa. Près de soixante ans. Georges de Caunes avait bien relaté son aventure en solitaire sur une île abandonnée des Marquises dans un journal intime mais Antoine n'avait jamais eu la force de déchiffrer son écriture en pattes de mouche. Ni surtout de revivre un traumatisme de jeunesse. Retour en 1962. Antoine est âgé de 8 ans. Cheveux bien peignés et culottes courtes. Son père, ce héros de la télévision et de la radio françaises, s'en va un beau jour. Lui, dont Robinson Crusoé est le livre de chevet, a décidé d'aller vivre un an sur une île déserte, en autarcie. Direction Eiao, en Polynésie française. Il imagine un concentré de paradis au bord d'un lagon aux eaux cristallines, c'est l'antichambre des enfers. Un caillou à la terre ingrate que chauffe un soleil impitoyable. L'air est saturé de moustiques vicieux, la mer infestée de requins.
Georges prend possession de son royaume inhospitalier, accompagné de son chien Eder. Dans ses malles, des bouquins, un émetteur radio pour enregistrer des émissions destinées aux oreilles hexagonales, de la nourriture, un fusil pour abattre les moutons et cochons qui prolifèrent sur l'île. Ses témoignages radiophoniques sont enlevés. La réalité, telle qu'elle apparaît dans son journal intime, est tout autre. Le journaliste souffre et commence bientôt à perdre pied. Littéralement. Il se casse la figure dans les rochers. Et s'il mourrait là, loin de tout, loin des siens ? Qu'est-il venu faire dans cette galère ? A Paris, Antoine ne cesse de se poser la même question. Une autre souffrance.
L'album, on peut parler de roman graphique (découvrez les premières pages), met en scène deux Robinsons, deux âmes en peine, deux hommes à l'amer. Georges l'exilé volontaire et Antoine l'enfant abandonné. Avec son co-auteur Xavier Coste, de Caunes junior renoue un dialogue interrompu par cette folle aventure. D'Eiao à Paris, père et fils se livrent, enfin réunis au fil des pages. Avec beaucoup de pudeur et de sincérité, Antoine dévoile les sentiments de chacun, parlant au nom du père et du fils. Sain d'esprit à son arrivée sur l'île, le premier se met à divaguer. La douleur, la solitude. Il frise la folie. Devenu papa à son tour, cheveux gris et pantalons longs, Antoine est désormais plus âgé que Georges le Robinson. Inversion des rôles. Explications entre hommes. Et si le père s'était conduit comme un gamin ? Certains passages sont bouleversants.
Xavier Coste apporte du souffle à ce récit à la fois intime et traversé par une envie d'aventure. Son trait fin et souple capture les émotions et la psyché des personnages. Formidable travail sur les couleurs : sobres, elles nous font ressentir la chaleur, l'ennui et le désespoir ; éclatantes, elles traduisent la violence du lieu, des situations, des pensées, elles font jaillir la folie, donnent corps à des visions dantesques, relatent l'inquiétante splendeur d'une nature sauvage, indomptée, mystérieuse. Trop grande pour l'homme. Dargaud a soigné l'édition, complétée par des documents d'époque commentées par Antoine. Un très beau livre. Un gros coup de coeur.
Anderton
Sans retour : le film culte de Walter Hill sort du marais 21 Mar 5:46 AM (28 days ago)

Ceux qui, comme moi, ont découvert Sans retour (Southern Comfort, 1981) sur une VHS empruntée au vidéoclub peuvent légitimement se réjouir de la ressortie en vidéo du film signé Walter Hill. Plus que la nostalgie, ce qui nous étreint, c'est la joie suscitée par la qualité de l'édition concoctée par L'Atelier d'images. Un must.
Premier constat : le film est toujours aussi prenant plus de 40 ans après sa sortie en salle. Walter Hill a réussi à fusionner thriller, survival et film de guerre, tout en flirtant avec le Nouvel Hollywood. Aucune posture chez le cinéaste. Sa mise en scène, d'une redoutable efficacité, est mise au service de l'action. Et de l'action, il y en a. Elle surgit brutalement comme la gueule d'un alligator planqué dans les eaux saumâtres. Les personnages ne sont pas oubliés. Chacun des neuf salopards parvient à exister à l'écran. Ce sont des figures bien dessinées, jamais des caricatures. Ils sont interprétés par un casting d'acteurs, tous excellents, avec des "gueules", qui dégagent une sacré présence à l'écran et parfois aussi une grosse dose de testostérone - ce qui n'est pas incompatible avec une finesse de jeu. Jugez-en : Keith Carradine (Nashville, Les Duellistes), Powers Boothe (La Forêt d'émeraude, Extrême préjudice), Fred Ward (L'Étoffe des héros, Short Cuts, Remo sans arme et dangereux), T. K. Carter (The Thing), Lewis Smith (Buckaroo Banzai, Wyatt Earp, Django Unchained), Les Lannom (vu dans Roots, Dr Quinn médecin, Les Têtes brûlées, X-Files), Peter Coyote (E.T. l'extra-terrestre, Un Homme amoureux, La Rançon de la gloire), Alan Autry (vu dans Cours après moi Shérif et L'Agence tous risques), Franklyn Seales (vu dans Hill Street Blues) et Brion James (Blade Runner, 48 Heures, Mort sur le grill, Le Cinquième Élément).
Hill, qui a cosigné le scénario, ne s'embourbe pas dans la psychologie, pas plus que dans le message politique. Car évidemment, ces Américains pourchassés dans les marais par un ennemi invisible nous rappellent les militaires, les vrais, qui tentent de survivre dans la jungle vietnamienne. Dans un entretien en bonus, le cinéaste admet du bout des lèvres que le film peut évoquer la situation au Vietnam mais rejette toute idée de parabole spécialement écrite dans cet esprit. Sans retour raconte surtout une Amérique désunie et paumée. Et, évidence qui pourtant passe au second plan, nous fait découvrir un autre monde, celui des Cajuns ou Cadiens. Une communauté francophone qui semble repliée sur elle-même et dont les us et coutumes interpellent les Gardes nationaux. Génial final dans un village cadien qui a organisé une "boucherie", une fête autour de cochons fraîchement abattus. Un choc des cultures entre soulagement et méfiance, partage, entraide et explosion de violence. Montage brillant de Freeman A. Davies.
Un beau retour dans les bacs
Le film est proposé dans une magnifique version restaurée qui nous permet d'apprécier à sa juste valeur la photo désaturée d'Andrew Laszlo (Les Guerriers de la nuit, Rambo, L'Aventure intérieure) et la bande originale entêtante composée par Ry Cooder. L'Atelier d'images n'a pas mégoté non plus sur les bonus. En maître de cérémonie, Philippe Guedj, journaliste et réalisateur qui ne cache pas son admiration pour le film. Dans un entretien complet, il décrypte le film et sa production pas piquée des vers. Il interviewe également Keith Carradine, qui égrène ses souvenirs du tournage. Walter Hill livre également sa vision d'un film qui s'est planté au box-office avant de trouver son public grâce à la vidéo. Sans retour, vous pouvez y retourner sans hésitation.
Anderton
BD - Grizzly Jam : le voyage de la femme qui a vu l'ours 15 Mar 4:21 AM (last month)

L'homme est frère des ours, pour reprendre le titre du film d'animation signé Disney. Et c'est probablement parce que nous partageons avec eux beaucoup plus qu'un régime alimentaire que notre relation oscille entre fascination et affrontement. Dans un magnifique album de BD, intitulé Grizzly Jam (Dargaud), Alice Chemama nous emmène au coeur du Grizzly Country, dans le parc de Yellowstone. Histoire d'aller voir la bestiole de plus près.
Direction l'Idaho. Marcia quitte la grande ville pour aller bosser le temps d'un été comme saisonnière au Sitting Bear Lodge, tenu par une amie de sa grand-mère. L'occasion de se ressourcer, de faire de la randonnée et de découvrir le parc national de Yellowstone. Dans ce pays du grizzly, l'ours est omniprésent. Sur les mugs, les t-shirts, les pots de confiture. Mais dans la nature, il est plus difficile à apercevoir. Pour autant, il faut s'en méfier. Bien fermer les portes et fenêtres, ne pas laisser traîner ses ordures et ne jamais sortir sans son spray anti-ours. Marcia aborde cette expérience avec excitation et un poil d'appréhension.
Inspirée par sa propre expérience dans le parc national américain, Alice Chemama signe un album immersif, à mi-chemin entre le nature writing et le récit de voyage, entre fiction et documentaire. Son dessin à la fois naïf et précis, sur lequel elle applique de splendides couleurs, nous transporte au plus près des émotions des attachants personnages et nous plonge au coeur de paysages somptueux, que des hordes de touristes prennent d'assaut, à la fois sans gêne et inconscients. Inconscients de leur impact sur l'environnement mais aussi du danger qu'ils encourent lorsqu'ils tentent d'approcher ours, élans ou bisons. On se sent Marcia tout en sachant qu'on fréquente aussi ces troupeaux de voyageurs accro à leur smartphone.
Jolie chronique estivale, belle réflexion sur notre rapport au monde sauvage, Grizzly Jam est publié dans une édition soignée (découvrez les premières planches) qui comprend en ours, pardon, en outre un reportage dessiné sur le Grizzly Country qu'Alice Chemama avait réalisé pour le magazine Topo. On y découvre plein de choses sur Yellowstone et ses habitants à fourrure. Le nounours laisse la place à une bête sauvage que l'autrice nous amène à respecter. Evasion totale.
Anderton
Comics - All-Star Superman : 12 exploits avant la mort 9 Mar 7:51 AM (last month)

Alors que James Gunn s'apprête à dévoiler sa version de Superman au cinéma, Urban Comics ressort dans une édition spéciale le All-Star Superman (2006) de Grant Morrison et Frank Quitely. Un récit culte empreint d'humanité et de tendresse.
Superman va mourir. En sauvant une équipe scientifique partie étudier le soleil, le super-héros s'est condamné. Une exposition trop longue à des radiations solaires critiques. A l'origine de ce drame, Lex Luthor. Qu'importe ! Le Kryptonien décide de ne rien révéler à Lois Lane, Jimmy Olsen, ses parents adoptifs et le reste des Terriens.
Avec cette histoire douce-amère mais pleine de souffle, Grant Morrison et Frank Quitely sont revenus aux origines de Superman, un super-héros mû par la bonté et l'amour envers la Terre et ses habitants. Une vision au premier degré, sans cynisme, ni ironie. Kal-El veut épargner la tristesse à ses proches, poursuivant ses missions mais aussi préparant l'avenir sans un gardien surhumain pour protéger sa planète d'adoption. Certes, il révèle à Lois que Superman et Clark Kent sont la même personne, il l'emmène dans sa Forteresse de solitude mais sa fiancée ne le croit pas.
Il était une foi
Cette franchise presque naïve associée au secret de sa mort prochaine rend le récit poignant. En douze épisodes parfaitement conçus, inspirés par les douze travaux d'Hercule, Morrison signe une ultime saga originale, riche en rebondissements, éclairée malgré tout par une bonne dose d'humour et surtout une foi inébranlable dans le super-héros de notre enfance. Tout sauf lisse, l'extra-terrestre apparaît ici dans toute son humanité.
Au dessin, Frank Quitely nous régale avec son style unique, à la fois réaliste et décalé, ultra-détaillé, empreint d'une certaine étrangeté et de drôlerie, entre Moëbius et Manara. Il saisit les personnages dans des postures souvent inhabituelles, fige parfois un instant dans un plan éloigné sans bulle ni onomatopée, nous surprend par son découpage et la composition de ses cases. Souvent, il clôt le chapitre par un dessin pleine page qui scotche le lecteur.
Urban Comics a soigné cette belle édition (découvrez les premières planches) en intégrant 26 pages de bonus, dessins, croquis, couvertures, extraits du scénario, le tout commenté par le duo d'artistes. Un album all-star.
Anderton
Anzu chat-fantôme : un film d'animation plein d'esprits 8 Mar 7:55 AM (last month)

Présenté à La Quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2024 et au Festival d'Annecy, Anzu chat-fantôme est désormais disponible en vidéo. Beau et touchant, ce film d'animation vous fera ronronner de plaisir.
Karin pensait aller rendre visite à son grand-père Osho, moine dans une petite ville du bord de mer. Une fois sur place, son père Tetsuya lui annonce qu'elle va y rester un bon moment, le temps qu'il règle ses dettes de jeu. La gamine est furieuse mais sa colère laisse place à la surprise lorsqu'elle découvre un drôle de paroissien : Anzu, un chat-fantôme rigolard et pétomane qui lui fait découvrir un monde insoupçonné. Pourtant, Karin veut retourner à Tokyo pour se recueillir sur la tombe de sa mère.
Adapté d'un manga, le film de Yōko Kuno et Nobuhiro Yamashita est un bijou d'animation. Les décors, splendides, nous font ressentir toutes les sensations d'un été dans une petite bourgade trop tranquille. Le soleil qui traverse le feuillage, le vent qui fait danser les fleurs, le miroitement d'une rivière, les insectes qui chantent, l'ennui et la torpeur qui engourdissent les corps... On retombe dans nos souvenirs d'enfance. Le duo de réalisateurs réussit à susciter chez les spectateurs des sensations et situations qui leur sont familières tout en les transportant au Japon. Et plus encore, ils font basculer cette réalité tangible dans un entre-deux plein d'étrangeté et de mystère.
Réalité magique
Premier décalage : comme Kuno et Yamashita l'expliquent dans un bonus du DVD édité par Diaphana, ils ont choisi de représenter les habitants de cette ville provinciale de manière plus "cartoonesque" que Karin, son père et tous les Tokyoïtes. Et puis, dans le sillage d'Anzu, voici qu'apparaissent des esprits qui peuplent la forêt ou se cachent sous terre. De drôles de personnages qui s'entichent de Karin et vont l'aider à surmonter sa peine. Cette irruption du fantastique fait évidemment penser aux productions du Studio Ghibli. Anzu chat-fantôme dégage peut-être moins de poésie et de souffle mais s'avère tout aussi émouvant et riche en rebondissements. Avec en prime une touche de gravité : la solitude et le deuil sont évoqués avec beaucoup de délicatesse.
Magnifique réussite que cette coproduction franco-nipponne, qui associe Shin-ei Animation et Miyu Productions. L'édition vidéo propose également en bonus des extraits du film tourné en prises de vue réelles, lesquelles ont ensuite servies de base à l'animation. Un procédé appelé rotoscopie qui participe à la réussite de cette oeuvre décidément originale et touchante.
Anderton
BD - Sur la trace de serial killers à fourrure et à six doigts 1 Mar 7:31 AM (last month)

Deux tueurs en série atypiques sont les protagonistes de bandes dessinées qui séduisent par leur originalité : dans Beneath the trees, Patrick Horvath détourne ce qui aurait pu être un récit pour enfants tandis qu'un collectif lance un feuilleton sanglant avec The One hand and the six fingers.
Patrick Horvath : Beneath the trees where nobody sees (Ankama)
Samantha tient une boutique de bricolage dans la petite ville de Woodbrook. Ici, tout le monde se connaît et s'apprécie. La vie s'écoule paisiblement et tout le monde y trouve son compte. Parfois, "Sam" va faire un tour à la grande ville voisine. Elle y kidnappe un inconnu qu'elle jette dans sa camionnette. Direction la forêt où elle démembre méthodiquement sa victime. Puis retour à Westbrook pour reprendre le cours de sa vie. Mais voici qu'un jour, un tueur se met à trucider horriblement des habitants. Pas question pour Samantha de laisser son havre de paix devenir un coupe-gorge. La serial killer traque l'assassin.
Cette belle idée - d'une tueuse en série obligée de pourchasser un encombrant copycat - est magnifiquement illustrée. Les personnages imaginés par Patrick Horvath semblent tout droit sortis de l'univers de Richard Scarry. Samantha est une oursonne toute mignonne et ses congénères sont d'adorables taupes, tortues, souris, chats et autres ratons-laveurs. Le choc n'en est que plus grand lorsque l'auteur représente les scènes de crime, ne cachant rien des saignées et éviscérations. Son récit avance au rythme d'une enquête haletante, ponctuée de séquences oniriques et d'une réflexion sur la part sauvage de ses personnages aux traits animaliers, comme lorsque Samantha se retrouve face à de vrais ours. Magnifique édition d'Ankama qui propose dans un cahier bonus des illustrations de l'auteur ainsi que les couvertures originales de l'oeuvre parue, comme souvent pour les comics, en série aux States.
Ram V, Dan Watters, Laurence Campbell et Sumit Kumar : The One hand and the six fingers (Urban Comics)
C'est à n'y rien comprendre. Une victime réduite à un tas de chair a été retrouvée au pied d'un mur recouvert de mystérieux hiéroglyphes et sur lequel l'assassin a laissé la trace ensanglantée de sa main. Particularité : l'empreinte laisse apparaître un sixième doigt. L'inspecteur Ari Nassar, qui était sur le point de partir en retraite, reprend du service. Il faut dire qu'il y a plus de vingt ans, il avait enquêté sur la même affaire, qui s'était soldée par 32 victimes. Un assassin avait été arrêté, puis un deuxième. Qui est donc ce nouveau tueur en série qui a repris les mêmes méthodes que ses prédécesseurs ?
Etonnant récit, co-écrit par Ram V et Dan Watters, qui relève à la fois de la science-fiction et du polar. Le 29e siècle ici représenté n'a rien de spontanément futuriste. Si ce n'est que les bordels sont équipés de robots qui ressemblent autant aux humains que les réplicants de Blade Runner. L'ambiance est glauque, le mystère épais. Au dessin, Laurence Campbell et Sumit Kumar. Le premier affiche un style très réaliste, caractérisé par sa noirceur (découvrez les premières planches) ; le second opte pour un trait plus clair. Chacun se partage un chapitre : avec Campbell, on suit l'enquête de l'inspecteur Nassar en même temps qu'on entre dans son intimité tandis que Kumar nous fait découvrir un chercheur en galère, amené à travailler avec des produits toxiques qui ont provoqué une étrange excroissance à sa main droite. La série est publiée en cinq parties mensuelles : deux sont déjà disponibles, la dernière paraîtra au mois de mai. De quoi nous rendre accro de mois en mois.
Anderton
Emmanuelle et Somna : l'érotisme au féminin 27 Feb 12:32 AM (last month)

Le désir des femmes vu par des femmes, cela donne l'occasion à une réalisatrice et un duo d'artistes de bande dessinée de revisiter deux mythes : celui d'un symbole de l'érotisme des années 1970 avec Emmanuelle, désormais disponible en vidéo, et celui des sorcières avec Somna, publié par Delcourt.
Emmanuelle : un voyage desireless
Il a fallu une bonne dose de courage et/ou d'inconscience à Audrey Diwan pour proposer sa version du roman éponyme d'Emmanuelle Arsan et entrer ainsi en compétition avec la première adaptation cinématographique signée Just Jaeckin (1974), l'un des plus grands succès du cinéma français, à l'affiche pendant dix ans dans une salle des Champs-Elysées. Avec sa coscénariste Rebecca Zlotowski, la cinéaste a gardé l'élégance et l'exotisme associés à l'histoire tout en apportant de profondes transformations. Exit Bangkok et l'expatriation lascive, direction Hong Kong, où Emmanuelle, responsable Qualité d'un groupe hôtelier, débarque pour inspecter un hôtel de luxe.
Dès la scène d'introduction, le ton est donné. Dans la classe business d'un avion qui file au coeur de la nuit, Emmanuelle se sait épiée par un homme qu'elle captive par quelques gestes sensuels. Elle se rend aux toilettes où le voyeur la rejoint et la prend sans un mot. Pendant l'acte, les yeux de la femme traduisent son manque d'intérêt. En sortant des toilettes, elle croise le regard d'un homme qui la fixe avant de refermer les yeux. Elle recroisera ce mystérieux individu dans l'hôtel où elle s'est installée. Audrey Diwan raconte donc la quête du désir chez une femme qui n'en ressent plus et qui est attirée par un homme dans le même cas. Même le luxe de l'établissement ne lui procure aucune stimulation. Tout est parfait donc factice et froid, malgré les expériences en solitaire, à deux ou à trois qu'elle enchaîne.
Cette quête a été conçue par la réalisatrice comme une montée en crescendo jusqu'à un final jouissif où Emmanuelle reprend possession de son corps et impose ses envies à un partenaire soumis. La femme n'est plus seulement un objet du désir masculin, elle affirme son pouvoir. Mais en asséchant l'érotisme des scènes de sexe et de séduction et en déroulant le récit au sein d'un environnement aseptisé (rien n'évoque vraiment Hong Kong), Audrey Diwan prive le public de l'excitation censée naître d'un film ouvertement érotique. D'autant que dans le rôle du mystérieux homme qui attire Emmanuelle, Will Sharpe peine à convaincre. Restent les bonnes prestations de Noémie Merlant, qui parvient à traduire les envies et frustrations de son personnage en se mettant à nu, pleinement, et de Naomi Watts. La photo et les décors sont magnifiques, la mise en scène élégante. Il y a de belles idées autour de l'eau associée au désir d'Emmanuelle : la piscine de l'hôtel où elle nage avant de succomber aux avances d'une jeune femme, les barrages que construit le mystérieux inconnu, la baignoire de celui-ci et dans laquelle Emmanuelle se plonge, le cyclone qui frappe l'archipel et ramène la vie dans l'établissement... Finalement, des scènes et des images restent imprimées dans notre mémoire mais la frustration domine. Dans l'édition vidéo, Pathé propose un bon entretien dans lequel Audrey Diwan et Noémie Merlant évoquent l'ambition qu'elles ont poursuivie avec ce film, dont elles racontent la fabrication et les ressorts.
Somna : le démon de ses nuits
Au XVIIe siècle, une femme mariée à un homme pieu est en proie à des rêves érotiques d'une troublante puissance. Ingrid est bientôt convaincue d'être possédée par une entité maléfique. Elle n'ose se confier à son époux alors qu'une sorcière a été brûlée dans le village.
Dans ce récit historico-fantastique, Becky Cloonan et Tula Lotay exploitent les fantasmes masculins projetés sur les femmes ainsi que les accusations de sorcellerie lancées pendant des siècles à celles qui laissaient juste libre cours à leur désir. A l'hypocrisie des hommes, leur volonté de domination et leur répression impitoyable, elles opposent finalement l'innocence d'une épouse négligée. La créature démoniaque la libère du carcan dans lequel l'enferment la société et la religion. Les styles très différents de chaque artiste s'associent merveilleusement bien : Cloonan dessine les séquences qui se déroulent dans la réalité, Lotay celles où Ingrid s'abandonne au démon. Les planches, somptueuses (à découvrir ici), exhalent sensualité et émotion au service d'un récit prenant qui touche au coeur. Somna a remporté l'Eisner (l'équivalent de l'Oscar de la BD aux Etats-Unis) de la meilleure nouvelle série en 2024. Delcourt la met en valeur avec ce bel album, qui intègre en bonus les couvertures originales et planches en noir et blanc.
Anderton
L'Enigme Velazquez : à la redécouverte d'un génie 25 Feb 12:31 AM (last month)

Il n'est pas toujours donné de pouvoir changer sa vision d'un artiste, de pouvoir réviser son jugement. C'est pourtant l'effet que provoque L'Enigme Velazquez, le film de Stéphane Sorlat qui sort ce mercredi sur nos écrans. Une passionnante plongée au plus près de l'oeuvre du peintre espagnol qui, à l'image de l'artiste même, n'a rien de classique.
J'ai découvert Velazquez au lycée, lors de mes cours d'espagnol. Mon professeur, castillan, avait décrypté l'un de ses tableaux les plus célèbres, Les Ménines, avec ses mises en abyme, ses jeux de miroir, le caractère révolutionnaire de sa composition, son impact sur Picasso qui l'a réinterprété à maintes reprises. Et j'en étais peu ou prou resté là, rangeant l'Andalou dans la catégorie des peintres classiques. Une vision réductrice.
Impressions d'un artiste
Pour le dernier chapitre de sa Trilogie du Prado (après Le Mystère Jérôme Bosch - pas vu - et L'Ombre de Goya, formidable), le producteur Stéphane Sorlat est passé derrière la caméra. Et il est bien décidé à nous surprendre, à nous amener à redécouvrir l'oeuvre exceptionnelle d'un artiste qui a fait entrer la peinture dans la modernité. Premier étonnement, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, le film ne s'ouvre ni sur un majestueux palais, ni sur une imposante salle de musée mais sur une rivière qui s'écoule paisiblement au coeur d'un écrin de verdure. Le spectateur, déconcerté, se demande s'il ne regarde pas un documentaire consacré à l'impressionnisme. D'autant que le réalisateur s'attarde à capturer le flot du cours d'eau puis le miroitement de l'onde, qui évoquent davantage les coups de pinceau de Monet. Et quand il nous fait visiter les splendeurs architecturales de Séville, ville de naissance de Velazquez, sa caméra en parcourt les corridors avec la même fluidité qu'une rivière. Dans un gracieux mouvement, elle plonge sur les pavés striés de vagues et se relève pour imprimer dans notre rétine de lumineuses embrasures. Elles évoquent autant celle qui figure dans Les Ménines que la succession des photogrammes d'un film.
Cette séquence donne le ton : l'incroyable précision des tableaux de Velazquez, leur raffinement, leur élégance, qui frappent de prime abord, ne sauraient occulter leur composition audacieuse et les mouvements vifs que l'artiste a appliqués par petites touches sur la toile pour en faire jaillir des éclats de lumière, des impressions, mais aussi des sensations. Les personnes qu'il a peintes nous transpercent de leur regard. Leurs visages disent leur caractère, dévoilent leur psychologie. Peintre de la cour, il n'hésite pas à reléguer les figures nobles à l'arrière-plan, ou à les associer à des roturiers. Il représente bouffons, mendiants, ivrognes, petit peuple dont il révèle l'émouvante humanité.
La vérité au bout du pinceau
De la peinture de Velazquez, se dégage une vérité alors inédite et que chercheront à retrouver Manet, Picasso, Dali, Bacon et bien d'autres. Au cours d'un beau voyage qui nous transporte de l'Andalousie à New York, en passant par la Suisse, Venise et, bien sûr, le Prado, Stéphane Sorlat est allé interviewer des spécialistes - critique d'art, conservateurs, restauratrice... - et des artistes, ou retrouver leurs témoignages au sein d'archives éclairantes. Tous disent leur admiration pour ce peintre d'une surprenante modernité et nous aident à mieux apprécier sa patte unique ainsi que la richesse de son oeuvre. A leurs voix, se mêle celle grave et profonde de Vincent Lindon, formidable narrateur du film.
Le réalisateur fait dialoguer les oeuvres du peintre avec celles de ses héritiers, y compris les plus inattendus. Elles se répondent, s'entrechoquent, s'éclairent mutuellement sous un nouveau jour. L'Enigme Velazquez une magnifique déclaration d'amour à Velazquez, à l'art, à l'Espagne.
Anderton
De Peter Ibbetson à The Brutalist : portraits de l’architecte en 10 films 18 Feb 4:35 AM (last month)

Acclamé à juste titre par la critique et le public, The Brutalist impressionne par la maîtrise de sa mise en scène, la complexité de son scénario, le jeu intense d’Adrian Brody 25 ans après The Pianist, de Roman Polanski, par la gravité de son propos, la richesse des thématiques abordées dans le cadre de l’Amérique apparemment idyllique des années 50. Surtout, il permet de remettre au centre de la réflexion une figure peu prisée jusque-là par le cinéma : celle de l’architecte. Pourtant quelques exemples existent. Et ce n’est qu’un début. Le point sur quelques figures marquantes.
Gary Cooper, ou l’idéaliste doux rêveur (Peter Ibbetson, 1930, Henry Hataway).
Tout d’abord, pour Henry Hataway, et son chef-d’œuvre chéri par les surréalistes, Peter Ibbetson. Dans le cadre de la riche société de l’Angleterre du XIXe siècle, il y incarne un architecte hanté par le souvenir de son enfance parisienne avec Mimsey, une voisine dont il était follement amoureux. D’une aura romantique, le film glisse progressivement vers un surréalisme célébré par André Breton, pour lequel Peter Ibbetson est "film prodigieux" qui montre le "triomphe de l’amour fou et de la pensée surréaliste". Si son talent d’architecte ne peut s’épanouir dans la réalité de la construction, Peter Ibbetson voit ses rêves éveillés advenir, ce qui lui permet d’échafauder un foyer pour Mimsey et lui-même.
Gary Cooper (bis), ou le génie en avance sur son temps (Le Rebelle, 1949, King Vidor)
Mais le grand rôle dans lequel Gary Cooper magnifie la figure de l’architecte est celle de Howard Roark, dans Le Rebelle, de King Vidor (1949), adapté du roman d’Ayn Rand. L’architecte interprété par Gary Cooper et inspiré par la vie de l'architecte génial et provocateur Franck Lloyd Wright y est décrit comme un individualiste nietzschéen triomphant, à rebours des conventions et de l’opinion publique et qui se révèle être le moteur du progrès technologique et donc social. Il est le génie ignoré qui seul réalise que le passé n’a aucun intérêt et qui démolit des logements sociaux qui ne correspondent pas à sa vision moderniste.
Michel Piccoli, ou l’architecte en pleine crise existentielle (Les Choses de la vie, 1969, Claude Sautet)
Michel Piccoli incarne Pierre, le parfait archétype de la bourgeoisie parisienne, aux prises avec des dilemmes de privilégié : partir ou rester, choisir entre deux femmes, s’évader au Maroc ou voguer au large de l’île de Ré. Rien de véritablement tragique, si ces hésitations n’étaient pas mises en résonance avec une réalité bien plus brutale : celle d’un homme mourant, incapable de savoir s’il aura encore le temps de réparer ses erreurs. L’arbitraire du drame souligne la fragilité de l’existence et fait écho aux thèmes chers au cinéaste : la crise de la quarantaine, qui semble dérisoire face à l’ampleur d’une vie ; la question lancinante des regrets, de l’indécision qui paralyse toute action et précipite la chute ; les plans d’une existence contre-carrés par la réalité d’un accident et la brutalité du réel.
William Holden, ou l’architecte en pleine idylle sans lendemain (Breezy, 1974, Clint Eastwood)
Frank Harmon, un architecte d’une cinquantaine d’années installé à Los Angeles, croise un jour la route de Breezy, une jeune autostoppeuse de 17 ans. D’abord distant et désabusé, cet homme au regard cynique se laisse peu à peu attendrir par l’énergie insouciante et la spontanéité de cette jeune hippie. En mars 1975, seuls quelques spectateurs français ont découvert cette œuvre dans la seule salle parisienne qui la projeta à sa sortie. Pourtant, malgré son échec au box-office, ce troisième film de Clint Eastwood marque l’une de ses premières incursions dans une chronique intime et mélancolique, qui voit s’opposer l’apparente maturité d’un artiste dans la force de l’âge, complètement déboussolé par l’insouciance de la jeunesse et d’une idylle sans lendemain – donc, utopique.
Paul Newman, ou l’architecte trompé par ses partenaires (La Tour infernale, 1974, John Guillermin)
Doug Roberts vient inaugurer la "plus haute tour du monde", haute de 138 étages, à San Francisco. Sauf que malgré ses avertissements, les consignes de sécurité n’ont pas été respectées par son promoteur immobilier. Et il se prend une volée de bois vert par le chef des pompiers (Steve McQueen) lorsque la tour prend feu et qu’il faut sauver les VIP du 135e étage. Il retrousse les manches et après un incendie épique, il se jure qu’on ne l’y reprendra plus. Vraiment ? Dès les années 70, ce film-catastrophe lançait le débat autour de la pertinence des tours. C’est le même aujourd’hui, quasiment dans les mêmes termes.
Jean-Pierre Bacri, ou l’architecte à la mauvaise conscience (Mort un dimanche de pluie, 1986, Joel Santoni)
Dans ce slasher à la française, l’architecte est celui par qui le scandale arrive : accusé d’être responsable de l’accident de chantier qui a causé la mort de sept personnes. Et cause du handicap de l’inquiétant jardinier qu’il s’apprête à embaucher, avec son épouse. A la fois drame domestique, thriller horrifique et conte gothique, Mort un dimanche de pluie déploie la figure d’un architecte en pleine crise, en proie à des accès de mauvaise conscience, sommé de défendre sa famille face à un couple sadique ivre de vengeance, dans le cadre d’une très grande maison d’architecte aux parois de verre, soumise à une interminable averse. Rare tentative de film de genre à la française, servie par un casting de luxe (Jean-Pierre Bacri, Nicole Garcia, Jean-Pierre Bisson, Dominique Lavanant).
Brian Dennehy, ou l’architecte ventripotent aux portes de la mort (Le Ventre de l’architecte, 1986, Peter Greenaway)
Stourley Kracklite, un architecte américain, est convié à Rome pour superviser une exposition consacrée à l’architecte français Étienne-Louis Boullée. Rapidement, il comprend qu’un certain Caspasian Speckler manœuvre dans son dos, cherchant à lui ravir son projet tout en séduisant sa femme, Louisa. Peu à peu, les monuments de Rome deviennent pour Kracklite un labyrinthe de marbre oppressant, tandis que d’insoutenables douleurs abdominales le rongent. Désemparé, il erre dans la ville, voyant peu à peu son emprise sur les événements lui échapper. Le spectateur partage son agonie, ressentant presque physiquement ses tourments. Entre la partition obsédante de Wim Mertens et la présence fantomatique de Boullée, figure centrale et obsessionnelle, ce film s’impose comme une expérience fascinante et troublante, organique et physique, au plus près des affres de la création architecturale.
Jeremy Irons, ou l’architecte quasi divin (High Rise, 2015, Ben Weathley)
Anthony Royal domine de sa superbe son œuvre : une tour de 40 étages dont la vie quotidienne des habitants s’organise selon une répartition et un schéma social censés créer l’harmonie : les moins fortunés, artistes ou cinéastes, habitent les étages inférieurs tandis que les nantis occupent les étages les plus élevés. Adapté d’un roman de J.G.Balard, le film décrit une tour régie par les principes que Le Corbusier a appliqués en 1947 à la Cité Radieuse de Marseille. Sauf qu’ici, ces principes censés simplifier et harmoniser les relations humaines volent rapidement en éclat : la jalousie et l’ambition dérèglent l’agencement ordonné du lieu. Avec morgue et orgueil, l’architecte Anthony Royal adopte une posture presque déiste sur ce petit monde qu’il a créé et qu’il dirige d’une main de maître. Mais face aux événements dont il est lui-même l’un des instigateurs il ne pourra qu’assister, impuissant, à l’échec de son projet social.
Adam Driver, ou l’architecte utopiste humaniste et mégalomane (Megalopolis, 2024, Francis Ford Coppola)
Enfin, tout récemment, avec César Catalina, Francis Coppola livre une vision de l’architecte en sur-homme prêt à défier les lois réglementaires, les lois physiques et les lois temporelles. Parce qu’il a mis au point un matériau miraculeux, le Megalon, qui lui a valu le prix Nobel de physique, le projet de Catalina le pousse à s’opposer au maire de la ville pour raser les logements sociaux situés au cœur de la ville afin de bâtir sa cité idéale, Mégalopolis. Démiurge ou visionnaire ? Le film ne tranche pas, même s’il penche résolument en faveur de la figure de l’architecte, représentation à peine voilée de Coppola lui-même en génie incompris.
Adrian Brody, ou l’architecte rescapé des camps de la mort (The Brutalist, 2024, Brady Corbet)
Laszlo Toth, architecte juif hongrois et rescapé de Buchenwald, arrive à New York en 1947. Accueilli par son cousin à Philadelphie, il est rapidement rejeté après un chantier raté. Déchu et en proie à la misère, il est finalement engagé par un millionnaire pour bâtir un institut en mémoire de sa mère. Il se consacre entièrement à son œuvre, refusant tout compromis malgré l’antisémitisme et la condescendance ambiants. Le film explore le brutalisme architectural, magnifiant le béton brut et la lumière, en s’inspirant des figures de Marcel Breuer et du Corbusier. À travers des séquences immersives, il raconte l’édification du bâtiment, symbole du calvaire de Laszlo et de son peuple.
Mais le troisième film du cinéaste, dont aucun film n’était jusque-là sorti en salles en France, ne se limite pas au portrait d’un homme : il esquisse l’envers du rêve américain et résonne avec les tensions contemporaines. La mise en scène virtuose (35 mm, en format VistaVision), la bande-son percutante et la performance d’Adrien Brody en font d’ores et déjà un classique du cinéma américain.
Travis Brickle
Comics - Gone : lutte des classes intergalactiques 15 Feb 6:38 AM (2 months ago)

La misère serait-elle moins pénible dans le cosmos ? Dans Gone (Delcourt), Jock signe une BD de science-fiction qui revisite la lutte des classes à l'ère des voyages intergalactiques. "No Future !"
Des toits de son ghetto situé aux portes d'un spatioport, Abi admire les gigantesques vaisseaux qui font voyager les élites dans une indécente opulence. Avec ses copains, ados comme elle, elle s'infiltre parfois dans les entrailles de ces monstres d'acier pour y dérober de la nourriture. Son père, qui travaillait à bord de l'un d'entre eux, lui en avait fait découvrir les corridors et moindres recoins. Avant de l'abandonner avec sa mère. Lors d'un énième raid, la teenager se retrouve bloquée à bord avec un groupe de terroristes. Décollage pour les étoiles. Abi doit alors survivre et échapper aux forces de sécurité qui la traquent dans les coursives du vaisseau.
Gone girl
Dans ce récit complet (lisez un extrait), le futur n'a rien d'idyllique. La misère y est même exacerbée, tout comme les inégalités. Jock nous plonge dans un monde sans espoir. Sombre comme son dessin et les couleurs qu'il y applique, avec son compère Lee Loughridge. Ambiance inquiétante, environnement poisseux... c'est tout le talent de l'artiste écossais de parvenir à donner au lecteur l'impression de respirer l'air pollué d'un bidonville puis l'atmosphère viciée de la soute d'un engin. On retrouve le même ressenti qu'au premier visionnage d'Alien. Le trait épais, noir, de Jock s'avère incroyablement précis pour représenter l'architecture et les structures au sein desquelles évolue Abi. Il utilise habilement ces labyrinthes de métal dans la composition des planches, juxtaposant les cases comme autant de plans cinématographiques pour dynamiser l'histoire, faire jaillir l'action, omniprésente, ou s'arrêter sur l'émotion des personnages.
Car jamais Jock n'oublie les protagonistes, et la première d'entre elle, Abi. Il nous fait vivre sa détresse, sa rage, son instinct de survie. Jusqu'à un final très émouvant. Gone fait le lien entre Les Misérables et The Creator. Un beau voyage.
Anderton
Pub Super Bowl 2025 : Matthew McConaughey, Matt Damon, les Muppets, des moustaches qui volent 9 Feb 8:37 AM (2 months ago)

En ce jour de Super Bowl (découvrez notre dossier), voici un florilège des pubs TV mettant en scène des célébrités.
Ritz : Aubrey Plaza et Michael Shannon font partie du Salty Club. Un Club salé qu'on pourrait traduire par amer en français. Mais ils ont trouvé plus salé qu'eux : les biscuits Ritz. Lesquels donnent le sourire à Bad Bunny.
Jeep : Harrison Ford filmé par James Mangold. Une pub faite pour inspirer. Avec une petite vanne à la fin...
Stella Artois : David Beckham découvre qu'il a un frère caché. Et pas n'importe lequel : Matt Damon. Et c'est en partie l'effet de l'alcool.
Michelob Ultra : en parlant de bière, faut pas test Willem Dafoe et Catherine O'Hara au padel quand l'enjeu est de s'enfiler une bonne blonde. L'ex-wide receiver Randy Moss, la basketteuse Sabrina Ionescu et le lanceur de poids Ryan Crouser ne le font justement pas, le poids.
Booking.com fait appel aux Muppets. On valide !
Haagen Dasz : il suffit d'une glace pour faire capoter un braquage. Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Ludacris ne sont plus aussi Fast and Furious...
Ray Ban x Meta : Le Super Bowl donne faim donc mais au point de manger de l'art ??? Chris Pratt, Chris Hemsworth et Kris Jenner jouent dans ce spot. Autant de Chris dans une pub pour Ray Ban. C'est à se demander si Kris va également profiter des retombées.
Dunkin' Donuts : la franchise de Boston mise sur les rejetons célèbres de la ville, à savoir Ben Affleck, Casey Affleck et Jeremy Strong. Et beaucoup d'autres !
You asked for more… so we delivered a full film. “DunKings 2: The Movie” is here 👏👏 pic.twitter.com/fTOFVqJQi9
— Dunkin' (@dunkindonuts) February 9, 2025
This might be our best work yet! @dunkindonuts #ad pic.twitter.com/gmu8PJ5s6H
— KevinSmith (@ThatKevinSmith) February 9, 2025
Hellmann's : Meg Ryan et Billy Crystal dans la sauce. Le duo rejoue la scène culte de Quand Harry a rencontré Sally pour une marque de mayonnaise. Sydney Sweeney fait un cameo.
Little Caesar's : Eugene Levy est un acteur sourcilleux mais qui a le sens de l'autodérision. Il accepte de perdre l'un de ses plus remarquables attributs faciaux le temps d'une pub.
Pringles : il n'y a pas que les sourcils qui s'envolent. Les moustaches aussi s'arrachent des visages de Nick Offerman, du basketteur James Harden et d'Andy Reid, le coach des Kansas City Chiefs, quand il s'agit de répondre à l'appel de l'affamé Adam Brody.
MSC Cruise : Tout le monde ne chante pas comme Madonna. Drew Barrymore a beau tenter d'interpréter Holiday, Orlando Bloom n'est pas convaincu.
Bosch : Antonio Banderas n'est pas la moitié d'un cornichon lorsqu'il s'agit d'ouvrir un bocal. Macho Man Randy Savage en reste coi.
Coors Light : on en revient toujours à la bière. Si toi aussi tu as adoré Timothy Simons dans Veep, tu seras content de le revoir, même barbu et même dans ce spot TV.
Squarespace : Barry Keoghan enfile à nouveau le costume de son personnage dans Les Banshees d'Inisherin pour distribuer des ordinateurs portables à des villageois irlandais interloqués.
HexClad : le chef Gordon Ramsay découvre que ses casseroles préférées sont fabriquées à partir de soucoupes volantes et que toutes les célébrités, comme Pete Davidson, sont des aliens.
Zeam et Taco Bells ont décidé de se passer de vedettes pour leurs spots diffusés pendant le "Big Game". Et pour cela, ils ont évidemment fait appel à des vedettes : respectivement John Stamos et Doja Cat.
GoDaddy : Walton Goggins montre les possibilités et les limites du jeu d'acteur. Avec un jeu de mot bien senti sur Uranus.
Homes.com : comme Heidi Gardner et Dan Levy n'ont le droit de rien dire sur le spot TV qui sera diffusé au Super Bowl, ils emploient quelques méthodes de contournement dans plusieurs teasers.
Mountain Dew : brainstorm dans l'agence de pub. "Et si Seal accompagnait Becky G dans ce spot ? Bonne idée, il pourrait chanter. Oui mais il faudrait que ce soit aussi marrant. Eureka !" Attention, jeu de mots.
Anderton
BD - Il était une case dans l'Ouest 8 Feb 4:22 AM (2 months ago)

On aurait pu penser que le western était un genre qui avait disparu dans l'horizon crépusculaire. C'est tout le contraire : il continue à cavaler sur grand et petit écrans (Horizon, The Power of The Dog, 1883, Yellowstone...). C'est aussi le cas en bande dessinée, comme en témoignent deux très bons albums qui flirtent avec le fantastique : Le Sacrifice des aigles (Delcourt) et Aucune tombe assez profonde (Urban).
Makyo et Eugenio Sicomoro : Le Sacrifice des aigles - tome 1 Dead Smile (Delcourt)
En pleine cérémonie traditionnelle, une communauté hopi est attaquée par une escouade de cavalerie. Massacre, viols. Un an plus tard, deux soldats confient à une prostituée un bébé abandonné devant les portes du fort. Puis un groupe de Hopis vient à la découverte de l'enfant au regard perçant. Il s'avère qu'il a un frère jumeau au sein de la tribu.
Makyo et Sicomoro signent un album hommage au western dans toute sa dimension mythique. Le scénariste français convoque les grandes figures de l'Ouest américain - Indiens qui tentent de survivre aux persécutions, cavalerie qui fait régner l'ordre et déchaîne la violence, habitants d'une petite ville perdue au milieu du désert, parias - et les confronte à un événement surnaturel qui les dépasse tous. En ces terres arides et disputées, la vie est rude, impitoyable. Les frontières du bien et du mal sont aussi floues que la ligne d'horizon brouillée par la chaleur. A quelques exceptions près, les personnages sont brutaux, racistes, lâches. Par son découpage et la composition des cases, Eugenio Sicomoro rend hommage aux grands classiques de John Ford. Majesté des paysages minéraux, expressivité des personnages magnifiquement illustrées par son beau trait réaliste. Impressionnant travail du coloriste Marco Ferraccioni. Du souffle, du drame, du mystère, ce premier tome (lisez un extrait) d'un diptyque est une grande réussite.
Skottie Young et Jorge Corona : Aucune tombe assez profonde (Urban)
Ryder vit paisiblement auprès de son mari et sa jeune fille dans une jolie demeure au coeur d'une nature digne d'un conte de fée. Mais la jeune femme se met à tousser du sang. Elle est condamnée et l'idée de perdre ce bonheur absolu lui est insupportable. Alors celle qui fut une terreur de l'Ouest connue sous le nom de Revolver Ridge Ryder remet son ceinturon et quitte son foyer. Elle est décidée à aller tuer la Mort.
Récit et dessin font la part belle au baroque. Aux paysages grandioses succèdent un outre-monde démesuré et peuplé de créatures étranges. C'est une odyssée à laquelle nous convie le duo d'artistes : la pistolera ne recule devant rien pour mener à bien sa quête. Elle fait cracher le feu, s'en prend plein la gueule mais jamais ne renonce. Des flashbacks de sa vie de famille l'aident à surmonter les épreuves qu'elle traverse. Shots de joie au coeur des ténèbres. Le grand format de l'album met en valeur le trait détaillé et vif de Jorge Corona ainsi que sa mise en page dynamique (découvrez les premières planches). On est plus proche de Sam Raimi que d'Howard Hawks. Reste que la dextérité du dessinateur est toute entière au service de l'histoire, pleine de fureur et de rebondissements, jusqu'à un final émouvant.
Anderton
City of Darkness : Hong Kong fou fou ! 6 Feb 6:11 AM (2 months ago)

Nostalgiques des films d'action made in Hong Kong, réjouissez-vous : City of Darkness est désormais disponible chez HK Vidéo. L'opportunité de découvrir ou revoir un film qui enchaîne les séquences de combats spectaculaires au sein d'un site incroyable et aujourd'hui démoli : la Citadelle de Kowloon.
Retour dans les années 1980. A cette époque, Hong Kong (découvrez notre dossier) attire son lot de migrants chinois qui cherchent une vie meilleure dans cet eldorado alors sous contrôle britannique. Chan Lok-kwun est l'un d'eux. Pour survivre, il participe à des combats clandestins organisés par la triade de Mr Big. En conflit avec son boss, le clandestin vole de la drogue et part se réfugier au sein de la Citadelle de Kowloon, une enclave chinoise, amalgame d'immeubles où vivent près de deux millions d'habitants au kilomètre carré ! Les membres de la triade n'osent pas pénétrer dans ce territoire dirigé par un gangster appelé Cyclone. Lequel prend Lok-kwun sous son aile. Mais Mr Big est bien décidé à se venger.
Le réalisateur Soi Cheang fait revivre un Hong Kong disparu, loin des néons multicolores et des vertigineux gratte-ciel, des malls aseptisés et de la mainmise chinoise. Un Hong Kong bordélique, rebelle, violent. A travers Chan Lok-kwun, nous pénétrons dans un labyrinthe en trois dimensions, impressionnant enchevêtrement de béton, ferraille et tôle où vit un petit peuple laborieux malgré l'exiguïté des lieux. Les décors sont impressionnants. Loin d'enfermer la mise en scène du cinéaste, ils lui offrent matière à créer des séquences d'action impressionnantes. Les fans de Jackie Chan et Donnie Yen de la grande époque retrouvent des sensations qu'ils pensaient perdues depuis les années 1990. D'autant que le grand Sammo Hung est au casting, incarnant le lien entre le passé et le présent d'un cinéma redevenu fiévreux.
Le savoir-faire des chorégraphes et cascadeurs de l'archipel n'est plus à démontrer. La moindre baston devient un ballet auquel participe la caméra. Au fur et à mesure que le film avance jusqu'à la bataille finale, les affrontements se font de plus en plus virevoltants. Oubliée, la gravité. Le fantastique et une forme de poésie s'invitent dans ces échanges de coups. C'est beau, c'est bon. On en redemande. Présenté au Festival de Cannes 2024, City of Darkness illuminera votre visage (même tuméfié).
Anderton
Hedy Lamarr raconte sa vie rocambolesque et sulfureuse 31 Jan 9:46 AM (2 months ago)

La maison Séguier poursuit sa noble et indispensable entreprise de réédition des mémoires de comédiens. Après Erroll Flynn, George Sanders, David Niven et Richard Burton, place à Hedy Lamarr. L'Autrichienne qui scandalisa avec son premier film très osé devint une star d'Hollywood, aussi célèbre pour sa beauté que pour ses frasques. Dans Ecstasy and Me, elle se raconte sans garder sa langue dans sa poche.
Alors adolescent, j'ai découvert Hedy Lamarr dans un film de Mel Brooks. Elle n'y est pas à l'affiche mais elle y est constamment citée. Dans le génial Le Shérif est en prison (Blazing Saddles, 1974), un procureur sans foi ni loi, interprété par Harvey Korman, a pour nom Hedley Lamarr. Evidemment, il est souvent appelé Hedy. Et lui de répondre à chaque fois en grinçant des dents : "C'est Hedley".
Ma curiosité aiguisée, j'ai alors découvert que ladite Hedy avait été une grande star hollywoodienne. J'ai dû la voir dans Samson et Dalila (Cecil B. DeMille, 1949) et peut-être dans un autre film. J'avais aussi lu qu'elle avait tourné dans Extase (Ecstasy, Gustav Machaty, 1933) où elle fit scandale pour y être apparue totalement nue et y avoir reproduit un orgasme lors d'un gros plan sur son visage. Elle n'avait alors pas vingt ans. Sa carrière était lancée. Direction l'Amérique.
En 1966, la comédienne, ruinée, empêtrée dans des scandales judiciaires et absente des écrans depuis près de dix ans, se décide à raconter sa vie. Sans fard, avec une franchise qui confine souvent à l'ingénuité, apportant au public les souvenirs croustillants qu'il espère. Car toute sa vie Hedy a cherché l'amour tout s'adonnant aux plaisirs du sexe. Résultats : six mariages conclus par six divorces, plus d'une centaine d'amants, et un nombre incalculables d'admirateurs plus ou moins (plus que moins) entreprenants. Dans son livre, elle décrit en détail les unions qui périclitent, parfois avec des extraits de journaux à l'appui mais sans acrimonie, rendant finalement hommage à ses ex tout en se dédouanant de leur avoir pourri la vie. Elle évoque également une relation toxique, des abus. Le mot viol est écrit mais elle reste discrète.
Holly olé
En revanche, elle n'hésite pas à raconter de long en large quelques parties de jambes en l'air. Avec des hommes et des femmes. Dans la nature, à l'arrière d'une voiture, dans une loge et même dans un peep show ! C'est tantôt excitant, tantôt tellement improbable qu'on hésite entre l'étonnement et le rire. Tout cela est bien troussé, et je parle aussi du style.
Surtout, Miss Lamarr nous fait pénétrer au coeur de l'Hollywood de la grande époque, celle où de puissants producteurs faisaient signer aux talents des contrats qui les liaient à un studio, ici la MGM. Les acteurs étaient des marchandises que des hommes puissants s'échangeaient, vendaient ou achetaient sans aucun scrupule. Hedy entre dans le détail de ses relations avec Louis B. Mayer, Cecil B. DeMille et quelques agents. Tous veulent la mettre sur pellicule et dans leur lit. La jeune femme résiste, négocie avec aplomb, parvient souvent à ses fins sans avoir à donner de sa personne contre son gré. Dans cet océan infesté de requins, l'Autrichienne mène sa barque, parvenant même à devenir productrice. Elle gère ses grossesses (elle est mère de trois enfants, dont un est adopté) en fonction de sa filmographie, ou l'inverse.
Le livre met en lumière les contradictions de son auteure, à la fois femme indépendante et habitée par une conception finalement très traditionnelle du mariage et de la psychologie féminine, comme elle l'expose à son psy. Hedy relate son engagement auprès des soldats en permission à Los Angeles pendant la deuxième guerre mondiale... mais jamais elle ne met en avant l'invention décisive qu'elle a développée avec le compositeur George Antheil : un principe de transmissions qui permet d'échapper aux radars ennemis et qui est encore utilisé de nos jours pour le wifi !
Heureusement l'éditeur nous permet d'en savoir plus dans une postface tandis que dans sa préface, Clémentine Goldszal invite à se rappeler que ces mémoires ont été en partie écrits par des ghost writers, qui ont certainement insisté sur les expériences les plus sulfureuses de la star afin d'aguicher le public.
Amour, santé, argent : "J'ai joui de ces trois choses en abondance et, à un moment ou un autre, les ai gaspillées toutes trois", conclut Hedy Lamarr, avant d'ajouter : "Je n'ai pas été sage". On referme son livre avec l'envie de la revoir à l'écran, pour mieux apprécier son jeu, trop souvent éclipsé par son ensorcelante beauté.
Anderton
Bertrand Blier : "Son thème favori, c'est la France, dans une forme délestée de tout naturalisme" 23 Jan 2:36 AM (2 months ago)

Anticonformiste, provocateur, amateur de bons mots, Bertrand Blier (1939-2025) s’était créé une place à part dans le cinéma français, avec l’assentiment du public et de la critique. De Hitler, connais pas (1963) à Convoi exceptionnel (2019), en passant par Les Valseuses (1974), Tenue de soirée (1986) ou Trop belle pour toi (1989), il laisse une œuvre singulière qui a marqué des générations de cinéphiles, par son audace, sa crudité, son humour et sa noirceur. Retour sur son héritage, ses influences, ses thématiques avec Vincent Roussel, auteur de la monographie la plus riche et la plus complète sur l’œuvre du réalisateur, Bertrand Blier, cruelle beauté, paru chez Marest Editeur en 2020.
Comment l'œuvre de Bertrand Blier a-t-elle influencé le cinéma français des années 1970 et 1980 ? En quoi Les Valseuses (1974) a-t-il marqué un tournant dans le cinéma français ?
Je ne suis pas certain que l’œuvre de Blier ait réellement influencé le cinéma français des années 1970 et 1980. Un film comme Les Valseuses marque plutôt une rupture avec ce qui se faisait à l'époque mais sans être vraiment suivi d'effets. Au début des années 1970, on assiste en effet à une vogue du naturalisme (les premiers Pialat) et de ce que Télérama avait nommé alors "le nouveau naturel", réunissant des cinéastes aussi divers que Pascal Thomas (Les Zozos), Joël Séria (Charlie et ses deux nénettes), voire Rozier (Du côté d'Orouët). Les Valseuses se distingue par une volonté affichée de ruer dans les brancards et de fuir ce naturalisme. Même si le film reste encore très linéaire comparé aux œuvres plus tardives du cinéaste, il y a déjà une volonté de stylisation (ces paysages français devenus presque abstraits) et de transcender le réalisme par l'humour, la provocation et une mise en scène elliptique. Si on peut néanmoins parler d'une "influence" de Blier sur le cinéma français, c'est dans la manière qu'il a eu de révéler de grands comédiens. Depardieu et Dewaere, ce sont de nouveaux corps et de nouveaux visages qui déboulent dans le cinéma français et qui révolutionnent la manière de jouer, un peu comme Belmondo chez Godard une quinzaine d'années auparavant. Je n'oublie pas non plus Miou-Miou ! Plus que par son style, assez unique, c'est dans sa manière d'offrir aux acteurs des rôles à contre-emploi (Delon, Blanc, Balasko, Coluche...) qu'on mesure son influence au sein du cinéma français.
Bertrand Blier, c’était avant tout un style d'humour noir et cru. Comment a-t-il été perçu par le public et la critique à l'époque de la sortie de ses films ? En quoi est-ce aujourd’hui une référence ?
Ça a toujours été quitte ou double. Après son succès en librairie, Les Valseuses est un triomphe dans les salles (plus de 5 millions de spectateurs) qui fait immédiatement (ou presque) entrer Blier dans la cour des grands. Le public est au rendez-vous mais d'emblée, la critique est divisée. Certains saluent un ton novateur et une bouffée d'air frais tandis que d'autres évoquent une "décharge publique" ou parlent d'une film "authentiquement nazi" ! Parenthèse piquante : alors que ce sont les conservateurs et les réactionnaires de l'époque qui attaquaient le plus violemment le film, c'est aujourd’hui l'aile dite "progressiste" qui le rejette avec le plus de virulence !
Par la suite, le public a été plus ou moins fidèle mais il faut attendre les années 1980 pour que Blier soit à la fois gage de succès populaires (Tenue de soirée, Trop belle pour toi) tout en étant également adoubé par la critique comme un véritable "auteur". Après Merci la vie, ses expérimentations sur la forme et la narration l'éloignent peu à peu du grand public et, si on excepte le joli score du Bruit des glaçons, ses films sont des échecs commerciaux, voire de francs bides (Les Côtelettes, Convoi exceptionnel). Du côté de la critique, c'est un peu la même évolution : les soutiens inconditionnels du cinéaste (il y en a !) se raréfient avec le temps.
Autre caractéristique : son amour des acteurs et des actrices. A quoi tient-il ?
J'imagine qu'il est difficile de ne pas l'être - amoureux - lorsqu'on est le fils d'un grand acteur comme Bernard Blier, que Bertrand fera tourner trois fois devant sa caméra. Parce qu'il a appris le métier avec des gens comme Clouzot, Christian-Jaque, Delannoy ou Lautner, Blier s'inscrit dans une tradition d'un cinéma très écrit, où la performance de l'acteur prime souvent sur la mise en scène. C'est aussi un amoureux des mots (Les Valseuses et Beau-père furent d'abord des romans), qui a toujours accordé une importance primordiale à celles et ceux qui allaient les dire. D'où l'importance d'avoir sous la main de grands comédiens. Il leur rendra d'ailleurs un vibrant hommage dans ce film curieux et à moitié réussi, Les Acteurs, qui résume à merveille l'évolution de ce métier au sein d'une industrie cinématographique en pleine mutation.
Quelles thématiques récurrentes peut-on identifier dans sa filmographie, et comment les a-t-il abordées ?
Vaste question ! A brûle-pourpoint, j'aurais envie de répondre que son thème favori, c'est la France. Alors que les petits voyous des Valseuses sont à deux doigts d'être livrés à la police par de "bons citoyens" qui se moquent de ces "zazous", Depardieu glisse à l'oreille de Dewaere une réplique restée célèbre : "Pas d'erreur possible, on est bien en France !" Tout va tendre chez Blier à fuir ce "cauchemar français" (pour reprendre une belle expression employée par Pascal Bonitzer, alors critique aux Cahiers du cinéma). Cauchemar géographique avec les stations balnéaires désertées dans Les Valseuses, les grands ensembles déshumanisés de Buffet froid, les résidences pavillonnaires interchangeables de Notre histoire, la banlieue déshéritée d'Un, deux, trois soleil... Mais fuir ce cauchemar, c'est aussi refuser tous les conformismes et accueillir en son sein des personnages en marge, réinventant à leur manière l'amour et le désir. Une des figures favorites de Blier, c'est le trio amoureux qui prend des chemins tortueux lorsque les personnages réalisent qu'on peut préférer une femme "ordinaire" à une beauté parfaite (Trop belle pour toi) ou un petit gros à un grand bellâtre (La Femme de mon pote). L'incongruité de ce désir permet à Blier d'aborder de nombreux thèmes autour du couple, du sexe (décomplexé), du plaisir (notamment féminin)... Ce désir peut se fixer sur un homme (Tenue de soirée), peut se nicher dans le parcours initiatique d'un adolescent rejeté, attiré par une femme plus âgée (Préparez vos mouchoirs) ou rapprocher une adolescente et son beau-père à la dérive (Beau-père).
Ce qu'il y a de particulièrement intéressant chez Blier, c'est que cet ancrage dans le territoire français s'exprime dans une forme délestée de tout naturalisme. Il arrive à parler de la réalité de son pays en passant par l'onirisme, l'absurde, l'humour noir...
Comment expliquer la reconnaissance internationale dont il a été l’objet, notamment avec l'Oscar du meilleur film étranger pour Préparez vos mouchoirs en 1979 ? Et la reconnaissance dont il a bénéficié (Cannes, les Césars) ?
Expliquer une reconnaissance internationale me paraît compliqué et c'est difficile de savoir ce qui a pu plaire aux Américains dans Préparez vos mouchoirs pour lui décerner un Oscar. Toujours est-il que cette récompense va ouvrir des portes à Blier, qui va pouvoir mettre en chantier Buffet froid en dépit d'un scénario à effrayer tous les producteurs ! On peut peut-être avancer que son cinéma, surtout dans les années 1980, est parvenu à trouver un équilibre entre une dimension "populaire" (des stars du box-office, un ton truculent et volontiers provocateur, une inclination pour la réplique tonitruante qui marque les esprits...), un style identifiable et une vraie patte d'auteur qui va réconcilier le public et la critique. L'exemple de Trop belle pour toi est assez stupéfiant. Si le film est très fluide, il est également totalement singulier dans sa narration (ellipses permanentes, télescopages de temporalités, situations incongrues et surréalistes...) mais il est à la fois acclamé par la critique et connaît un étonnant et très beau succès en salles, avec plus de deux millions d'entrées, suivi d'une belle consécration aux César. Mais Blier n'a jamais aimé se reposer sur ses lauriers et il trouve son film trop "bourgeois". Alors il décide de tourner une sorte de remake au féminin des Valseuses. Ce sera Merci la vie qui marquera le début du divorce entre le cinéaste et le public même si ce film connaîtra encore un beau succès.
Depuis Mon homme, il semble avoir subi un retour de bâton de la part du public et de la critique. Comment l’expliquer ?
J'y vois deux raisons. La première, comme expliqué auparavant, tient sans doute à cette volonté de Blier de ne pas s'ennuyer et ne pas refaire le même film. Les expérimentations de Merci la vie et Un, deux, trois, soleil ont pu déconcerter le public. D'autant plus que Blier ne refera plus jamais un film linéaire et "classique".
La deuxième tient au changement d'époque pointé dans ce film spectral qu'est Les Acteurs. Dans les années 1970 et 1980, les films peuvent se monter sur les noms des comédiens, ce qui permet à certains auteurs de connaître de beaux succès tout en manifestant une véritable ambition artistique - songeons à quelqu'un comme Michel Deville, par exemple. Blier, en faisant tourner des stars comme Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Delon, Depardieu, ou les vedettes du café-théâtre (Michel Blanc, Josiane Balasko, Coluche...), a pu se permettre de leur donner des rôles à contre-emploi tout en obtenant (plus ou moins) l'adhésion du public. A partir des années 2000, avec le morcellement des pratiques (les chaînes câblées puis l'arrivée d'Internet), le star-system à la française ne fait plus recette et une affiche avec des acteurs populaires (Bouquet et Noiret dans Les Côtelettes, par exemple) ne suffit plus à déplacer les foules. Délaissé par la critique (et donc les cinéphiles) qui le réduit à ses mots d'auteurs et son petit théâtre pirandellien (la formule "Audiard + Godard" ou "Audiard + Buñuel" est ressassée à l'envi), il n'attire plus le public sauf lorsqu'il arrive à trouver un regain de jeunesse avec Dujardin et Dupontel pour Le Bruit des glaçons.
Quelles ont été ses influences ? Et quel héritage laisse-t-il aux réalisateurs contemporains ?
Quand il parle de ses cinéastes préférés, Blier cite souvent de très grands noms du cinéma : Kubrick, Fellini, Buñuel, Godard et, plus près de nous, David Lynch. Mais je ne sais pas si on peut parler d'une réelle influence tant son cinéma est aussi redevable à une certaine tradition très française (notamment Clouzot à qui il rend hommage dans Convoi exceptionnel). Quant à ses héritiers, le plus évident me paraît être Quentin Dupieux (difficile de ne pas songer à Buffet froid devant Au poste !) mais ils sont peu nombreux (qui se souvient du film de Didier Le Pêcheur Des nouvelles du bon Dieu ?). Notons cependant que les acteurs-réalisateurs qui ont tourné sous sa direction ont pu être influencés par son style : quand elle tourne Gazon maudit, Josiane Balasko se montre plus corrosive qu'à l'accoutumé et signe une sorte de version féminine de Tenue de soirée. Et que dire de Grosse fatigue de Michel Blanc, réalisé sur une idée de Bertrand Blier ?
Aujourd’hui, pourquoi et comment donner envie de découvrir ses films ? Et lesquels en particulier ?
Un cliché veut que ses films aient pris quelques rides, reflets d'une époque qu'on ne souhaite plus regarder (les années 1970 et leurs excès). Or je trouve que, justement, revoir les films de Blier permet de se replonger dans des époques différentes et de les appréhender de manière nuancée. Il y a une profonde ambivalence qui traverse le cinéma de Blier. Nous n'avons pas le temps de nous étendre sur l'étiquette de misogyne qu'on lui a accolée depuis Les Valseuses mais gardons-nous cependant de ne voir ses films qu'à l'aune des grilles idéologiques de notre époque. Ils sont effectivement le reflet de leur époque et d'une violence, essentiellement masculine, mais ils témoignent aussi des profondes mutations de la masculinité (les machos des Valseuses sont incapables de faire jouir Miou-Miou, à l'inverse du jeune homme timide et maladroit qui a pris le temps de l'embrasser). Il faut savoir faire la distinction entre les actes des personnages (fictifs, donc) et le regard du cinéaste qui sait se montrer ironique à leur égard. En gardant cette distance, on pourra alors apprécier ces pépites que sont Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs, Buffet froid, Beau-père, Notre histoire, Tenue de soirée ou encore Trop belle pour toi.
A lire : Bertrand Blier, Cruelle beauté, de Vincent Roussel, chez Marest Editeur.
Travis Bickle
Better Man : Robbie Williams jongle avec ses démons 21 Jan 11:18 PM (2 months ago)

Avec Better Man, c'est un biopic très original et très réussi que nous propose Michael Gracey. Celui de Robbie Williams, qui y apparaît sous les traits... d'un singe. Je vous donne cinq bonnes raisons d'aller voir le film qui sort aujourd'hui au cinéma. Mais avant cela, une confidence :
J'avais environ 30 ans lorsque j'ai rencontré Robbie Williams dans un restaurant londonien en 1997. Il avait démarré sa carrière solo après avoir quitté le boys band Take That. Il dînait en compagnie de Nicole Appleton du groupe All Saints et moi, j'étais déjà fan de lui ! On entendait Angels en boucle sur la radio Channel 4 et j’étais fascinée par sa personnalité extravertie, son allure sexy et provocatrice. Ce soir là, je n ai pas osé lui parler. Il a vu que je l’observais et il a fait une grimace dans ma direction, qui disait "Et oui, c'est moi". Alors, j'ai détourné mon regard. Plus tard, il a enchaîné les tubes et moi, je les écoutais inlassablement. Ses chansons me donnaient une incroyable énergie.
Je ne savais pas que sous cette exubérance, il cachait une nature plus noire et se débattait perpétuellement contre ses démons à chaque étape de sa vie : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. C’est ce que nous apprend Better Man, réalisé par Michael Gracey, à qui l'on doit The Greatest showman. Son ego surdimensionné et ses frasques dissimulaient un enfant blessé, en proie au doute, à la peur, l’abandon.
Lors de l’avant-première au Grand Rex, le 13 décembre 2024, il s’est montré sous un autre jour, dévoilant un homme en paix avec lui-même.
Dans le film, le chanteur a choisi de se montrer sous les traits d’un singe. Comme si, depuis l’enfance, il était resté au stade primitif. Devenir "un homme meilleur" prend du temps. A presque 51 ans, Robbie n’a plus rien à prouver si ce n’est qu’il reste le plus grand showman de sa génération et pour cela, il nous donne rendez-vous le 2 juillet 2025 à La Défense Arena.
En attendant, voici cinq bonnes raisons d’aller voir Better Man :
- Parce que le personnage principal est un singe en images de synthèse, prouesse technologique de Wētā FX. Cette société d’effets visuels numériques et d’animation, située en Nouvelle-Zélande,a notamment créé les personnages de Gollum dans Le Seigneur des anneaux, César dans La Planète des singes ou des Na'vis dans Avatar).
- Parce que le remix d’Angels avec orchestre nous file la chair de poule. Et dans le contexte du film la chanson prend toute son ampleur. Je valide pour la deuxième fois !
- Pour les scènes de danse entre folie et poésie chorégraphiées magnifiquement par Ashley Wallen.
- Parce que Robbie Williams est l’un des artistes musicaux les plus récompensés avec 85 millions d’albums vendus dans le monde et que malgré cela, il avoue sa vulnérabilité et ses angoisses et que ce film est une belle leçon d’humilité et de résilience.
- Parce que le personnage principal est encore en vie, contrairement à beaucoup de biopics et qu’on peut féliciter Robbie de continuer à faire le show pour nous.
Mrs Peel
BD : voir Naples et frémir 3 Jan 5:55 AM (3 months ago)

Le monde entier n'est peut-être pas un cactus mais Richard en est assurément un. Avec Alessia, un bel album de bande dessinée publié chez Delcourt, Zidrou et David Merveille s'associent pour évoquer ce piquant peintre de retour à Naples. Une passeggiata colorée et mélancolique.
Richard Gordon Cactus est revenu passer quelques jours en terres napolitaines. Pour revoir son amie marquise, pour se rappeler son ancien amour Alessia. "Pour la lumière de Napoli, aussi", avoue-t-il à la Marchesa. Des retrouvailles et des déambulations au rythme des vers du poète L.C. Sterret. Eclat de sensations sous le soleil de Campanie. Ici, c'est le bruit d'un bouteille de greco di tufo qu'on débouche ; là, la vision d'un Praxitèle surgi des flots ; ailleurs, la contemplation de la cité adossée au Vésuve en croquant dans une sfogliatella. On pense à un film d'Antonioni. Marcello Mastroianni aurait été parfait en R.G. Cactus, la marquise fatiguée aurait pu avoir les traits de Silvana Mangano. Et Alessia, la grande absente qui hante l'artiste ?
Zidrou signe un récit tout en délicatesse sur le temps qui passe et la permanence des sentiments. Plaisirs futiles et réflexions profondes se mêlent dans le décor somptueux de la côte amalfitaine. Le dessin élégant de David Merveille, son subtil travail sur les couleurs, contribuent au charme de cet album (découvrez les premières planches) qui dégage une douce mélancolie et une grande tendresse pour le bel paese.
Anderton
Emilia Perez : la comédie musicale d'un nouveau genre 2 Jan 4:42 AM (3 months ago)

Jacques Audiard poursuit son travail sur la quête d'identité avec Emilia Perez, ovationné et récompensé au Festival de Cannes 2024 et désormais disponible en vidéo. L'occasion de se replonger dans un oeuvre fascinante et d'en découvrir l'original processus de création.
Ce n'est pas spoiler le film que d'en raconter l'histoire. Celle d'un implacable chef de cartel qui décide de mettre fin à ses activités et de devenir une femme. Pour l'assister dans cette transition, le boss mexicain fait appel à une avocate brillante mais qui oeuvre dans l'ombre d'un ténor du barreau. Si elle accepte le contrat, à elle la richesse. A la condition de garder l'affaire secrète, y compris auprès de la femme et des enfants du malfrat.
L'audace d'Audiard
Ce qui frappe tout au long du film, prix du jury à Cannes, c'est son audace. Audace formelle, d'abord. N'en déplaise à certains spectateurs mexicains qui ont critiqué la représentation de leur pays et la faible présence de comédiens locaux en tête d'affiche, le film nous transporte dans un Mexique vibrant, coloré, excessif. Et pourtant, le tournage s'est déroulé intégralement en studios, en Europe. L'opportunité pour Audiard de contrôler totalement l'environnement - et de s'imposer quelques contraintes - pour proposer une vision ultra-stylisée et une mise en scène virtuose. Sa caméra fait exploser les décors et basculer les ambiances lors des séquences chantées et dansées. On perçoit ici un hommage à Bob Fosse, là à Busby Berkeley, mais toujours avec une approche moderne, transgressive, non dénuée d'humour, à l'instar des morceaux composés par Camille et Clément Ducol et de la chorégraphie de Damien Jalet. Le cinéaste est aussi formidablement aidé par Paul Guilhaume (photographie), Virginie Montel (direction artistique et costumes), Emmanuelle Duplay (décors), qui contribuent à créer cet univers qui s'inscrit pleinement dans le réalisme magique popularisé dans les romans des grands auteurs latino-américains.
Audace encore dans le choix de tourner le film en espagnol avec des comédiens aux profils très différents : Zoe Saldaña l'Américano-dominicaine, Karla Sofía Gascón l'Espagnole, Selena Gomez l'Américaine aux lointaines origines mexicaines (mais qui ne parle pas très bien espagnol, cela s'entend dans le film) et Adriana Paz la Mexicaine. Quatre fortes personnalités qui livrent des prestations très émouvantes. Prix d'interprétation féminine collectif à Cannes totalement mérité. N'oublions pas pour autant les interprétations marquantes d'Edgar Ramirez (dont le personnage est l'incarnation de la violence masculine) et de Mark Ivanir dans le rôle du chirurgien.
Identité et transgression
Audace toujours d'un scénario construit autour d'un personnage issu du roman Écoute de Boris Razon. Jacques Audiard brosse les portraits et interrelations de femmes qui se cherchent et finissent par se trouver, affirmant leur indépendance dans un monde machiste. Toutes s'engagent dans une quête de leur identité profonde, au-delà de celle que leur imposent la société et parfois même leur corps, et dans un difficile mais libérateur processus de transformation physique et mental. Aux gros sabots, le cinéaste préfère les pas de danse délicats ou affirmés, sans jamais oublier les enjeux dramatiques ni l'émotion.
Audace enfin d'une démarche artistique que Pathé nous révèle dans deux excellents bonus. L'un présente les coulisses du film, l'autre est un passionnant entretien entre Jacques Audiard et Philippe Rouyer. Le journaliste amène le cinéaste à raconter son process de création et à revenir sur ses thématiques de prédilection. Scénario, chansons, tournage... les étapes semblent se télescoper, en fait elles s'enrichissent mutuellement jusqu'à la fin de la fabrication du film. Pour un résultat exaltant.
Anderton
Apple TV+ : les séries 2024 qu’il ne fallait pas rater sont... 22 Dec 2024 6:31 AM (3 months ago)

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans l’offre pléthorique des plateformes de streaming. Pourtant, cette année, c’est Apple TV+ qui s’est démarquée avec une sélection de séries remarquables que j’ai suivies jusqu’au bout. À l’inverse, des productions comme The Gentlemen de Guy Ritchie sur Netflix ou Fallout sur Amazon n’ont pas réussi à maintenir mon intérêt, malgré une mise en avant importante par leurs plateformes respectives. Sans prétendre avoir tout vu pour autant car il me reste encore beaucoup à découvrir, ces choix ont cependant marqué mon année !
1) Sugar (Apple TV+)
Une petite virée à Los Angeles vous tente ? Colin Farrell vous réserve une place dans sa Chevrolet Corvette 1953 décapotable. Dans Sugar, disponible sur Apple TV+, il interprète le rôle d’un détective privé américain tout droit sorti d’un film noir, et féru de cinéma. Sugar confirme le talent de Colin Farrell et le parti-pris de la plateforme : proposer moins de contenus mais faire des choix artistiques pointus et audacieux (Hijack, Silo, Ted Lasso...). Une saison 2 a d’ores et déjà été annoncée par la plateforme.
2) Disclaimer (Apple TV+)
Disclaimer vient d’obtenir 3 nominations aux Golden Globes 2025. Disclaimer d’Alfonso Cuarón est une pépite de plus dans l’offre déjà exceptionnelle d’Apple TV+. Présentée sur grand écran à la Mostra de Venise mais aussi au Festival Lumière à Lyon en présence du réalisateur mexicain, la série – qu’il décrit lui-même comme un film en sept chapitres (un an de tournage au total) – est portée par Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen, Kevin Kline et Lesley Manville. "Méfiez-vous du récit et de la forme", nous dit-on dès le départ. Une série qui brille par l’intelligence de sa mise en scène et par la force de son message nécessaire. Accrochez-vous.
3) Présumé Innocent (Apple TV+)
Adaptation réussie du roman éponyme de l’écrivain américain Scott Turow - déjà portée à l’écran avec Harrison Ford sous la direction d’Alan J. Pakula (L’Affaire Pélican, Les Hommes du Président) –, la série revisite avec brio une intrigue captivante. Portée par un casting de haut vol, elle est produite par J.J. Abrams et David E. Kelley.
Jake Gyllenhaal incarne Rusty Sabich, un procureur brillant dont la vie bascule lorsqu’il est accusé du meurtre de Carolyn Polhemus (Renate Reinsve), une jeune et ambitieuse collègue avec qui il avait récemment entretenu une liaison passionnelle. Peter Sarsgaard (Jarhead, 5 septembre) excelle dans le rôle de Tommy Molto, le procureur adjoint chargé de poursuivre Rusty, tandis qu’O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale) interprète Nico Della Guardia, un procureur général prêt à tout pour protéger sa réputation en pleine tempête médiatique. Enfin, Bill Camp (Le jeu de la Dame) brille en Raymond Horgan, le mentor de Rusty.
4) Dark Matter (Apple TV+)
Adapté du roman éponyme de Blake Crouch publié en 2016, Dark Matter est un thriller de science-fiction sombre et passionnant. Hyperréaliste dans sa vision, la série s’appuie sur les performances remarquables de Joel Edgerton (The Stranger, The King, Warrior) et de Jennifer Connelly (Requiem for a Dream, Un homme d’exception), sans oublier l’excellent Jimmi Simpson, mémorable dans Westworld.
Jason Dessen (Joel Edgerton), père de famille, est enlevé et emmené dans un autre monde où sa vie n'est pas la sienne. Son voyage pour rentrer chez lui l'emmène à travers des mondes qu'il n'aurait jamais pu imaginer, afin de retrouver coûte que coûte sa femme (Jennifer Connelly) et son fils (Oakes Fegley). La série a été renouvelée pour une deuxième saison.
Joanna Wallace
Noël sous le signe de Zorro 20 Dec 2024 5:58 AM (3 months ago)

Alors que France 2 s'apprête à diffuser la série Zorro, avec Jean Dujardin dans le rôle-titre, Urban Comics édite un recueil des aventures en bande dessinée du justicier californien. Signés Alex Toth, ces épisodes sont inspirés par la série produite par Walt Disney.
Le 10 octobre 1957, ABC diffuse le premier des 78 épisodes de la série Zorro produite par les Studios Walt Disney. Pendant 25 minutes, les spectateurs sont projetées à Los Angeles en 1820, alors sous domination espagnole. De retour d'Espagne, Don Diego de la Vega découvre que le village vit sous le joug du commandant Monasterio. C'en est trop pour le jeune hidalgo qui revêt un masque et un costume noir pour se transformer en justicier. "Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. D'un Z qui veut dire Zorro" (Renard). Impossible d'oublier les paroles du générique culte, dont la musique est composée par George Bruns, à qui Oncle Walt doit d'autres pépites (Yo-Ho, la chanson de l'attraction de Pirates des Caraïbes, les B.O. du Livre de la Jungle ou de Robin des Bois entre beaucoup d'autres).
Le sourire et le rire de Guy Williams, la bonhommie du sergent Garcia, la malice de Bernardo, les combats d'épées, les cavalcades dans la nuit... tout le charme de la série se retrouve dans les courts épisodes de la bande dessinée. Les histoires sont écrites par les scénaristes de la série et Alex Toth est chargé de les mettre en images. Dans la préface de l'album, il peste d'ailleurs contre les dialogues trop longs, lui qui aurait préféré consacrer plus de cases à des séquences d'action. Avec beaucoup d'honnêteté et trop de modestie, l'artiste explique également que "certains de ces épisodes (...) sont plutôt bons, et d'autres pas terribles". Je le trouve très sévère avec lui même. Son trait élégant, souple et vif apporte beaucoup de dynamisme à cette adaptation qu'on lit avec un grand plaisir (découvrez les premières planches). Certaines expressions des personnages font parfois penser au style d'Hugo Pratt à ses débuts (l'Italien a-t-il été influencé par l'Américain ?).
L'album est complété par une histoire inédite de Zorro, signée Howard Chaykin et Eduardo Risso - deux maîtres de la bande dessinée -, et par plusieurs bonus édifiants sur Zorro, Alex Toth et son oeuvre. Une galerie de photos de la série, de couvertures de revues et d'affiches (Walt Disney a produit également des téléfilms qui ont été distribués au cinéma à l'international) conclut ce recueil de plus de 300 pages. Les amateurs du Renard noir pourront également se précipiter sur un autre album édité par Urban Comics : Zorro d'entre les morts. Sean Murphy revisite avec audace le mythe du justicier masqué. Après Paramount+, la série avec Jean Dujardin sera, elle, diffusée à partir du 23 décembre sur France 2.
Anderton
Danny Elfman, Tim Burton et John Mauceri : un concert extraordinaire à Paris 18 Dec 2024 12:23 AM (4 months ago)

Danny Elfman, c'est 35 ans de collaboration avec Tim Burton. Compositeur de musiques de films et de musique classique, auteur-compositeur-interprète, il nous en a mis plein les oreilles lors d'une soirée exceptionnelle au Zénith de Paris le 15 décembre. Découvrez nos vidéos.
Originaire de Los Angeles, Elfman n'était pas venu dans notre capitale depuis sept ans. C'est pourtant la France qui a lancé sa carrière de musicien grâce à Jérôme Savary et au Grand Magic Circus. Au Zénith, il était accompagné de l'orchestre symphonique Colonne (l'un des plus anciens de France), dirigé par John Mauceri. Au palmarès de ce chef d'orchestre américain multi-récompensé : des opéras dans les salles les plus prestigieuses (La Scala, Metropolitan Opera...), des comédies musicales à Broadway et plus de 300 concerts à la tête du Hollywood Bowl Orchestra, à Los Angeles.
Elfman a signé les bandes originales de 17 films de Tim Burton, dont celles de Batman, Pee Wee's Big Adventure, Beetlejuice, Edward aux mains d'argent (Edward Scissorhands) et celle du mémorable L'Etrange Noël de Monsieur Jack (The Nightmare before Christmas) dans lequel il interprète Jack Skellington. Un rôle qu'il a repris sur la scène du Zénith.
Elfman a également composé pour de nombreux autres réalisateurs, dont Gus Van Sant pour Good Will Hunting, sans oublier la musique de séries légendaires comme Desperate housewives.
Voici deux autres extraits de la soirée en attendant de découvrir sa prochaine collaboration musicale avec Luc Besson pour Dracula, a love tale.
Un extrait du solo extraordinaire de la violoniste américaine Sandy Cameron sur Edward aux mains d’argent.
Mrs Peel
BD - Détective cosmique, demi-dieu sanguinaire, chasseuse de zombies et anti-héros sur le retour 16 Dec 2024 12:20 AM (4 months ago)

Petite sélection de bons comics à découvrir et offrir à Noël. La saga BRZRKR, cocréée par Keanu Reeves, et l'univers Walking Dead s'enrichissent de spin-offs tandis que des seconds rôles de DC Comics reviennent au premier plan et qu'un détective cosmique fait son apparition.
Keanu Reeves, Steve Kroce, Mattson Tomlin, Rebekah Isaacs, Dave Stewart & Dee Cunniffe : BRZRKR Bloodlines (Delcourt)
Oui, ça en fait du monde pour un album de bande dessinée. Keanu Reeves est à l'origine de la saga BRZRKR, ce qui explique que le héros ait les traits du comédien. Unute est un demi-dieu qui succombe parfois à une rage qu'il apaise lors d'épisodes de violence extrême. Il traverse ainsi les siècles, vénéré comme un héros ou redouté comme un fléau. Après trois premiers tomes réussis, la série Bloodlines exploite les aventures du personnage à travers les âges. Deux récits composent cet album. Celui de Steve Skroce raconte comment Unute, protecteur d'une cité, doit affronter une secte qui a placé le souverain du royaume sous son emprise. J'adore le dessin ultra-précis de Skroce qui prend son pied, enfin sa main, à détailler les éviscérations et autres démembrements sanguinolents provoqués par le berserker (la preuve en images). Une violence crue qui est la marque de fabrique de la saga et que l'on retrouve dans le second récit, signé Mattson Tomlin et Rebekah Isaacs. Une histoire où il est question de la fin d'une civilisation, de vengeance, d'amour, de trahison... Ces spin-offs réussissent leur objectif : enrichir la trilogie tout en pouvant être lus de manière indépendante.
Jeff Lemire, Matt Kindt & David Rubin : Cosmic Detective (Delcourt)
Un ____ est retrouvé assassiné. Or, les ___ ne sont pas censés mourir. Les répercussions pourraient être cataclysmiques. Un Cosmic Detective enquête sur l'affaire. Jeff Lemire et Matt Kindt (qui a cocréé BRZRKR avec Keanu Reeves) signent un scénario qui emprunte autant à la science-fiction qu'au polar hard-boiled. Fausses pistes, chausse-trapes, mystère et sales coups parsèment le chemin du détective qui en prend, évidemment, plein la tronche. David Rubin (déjà associé à Matt Kindt sur l'excellente série Ether) joue avec les cases et les formes géométriques, multiplie les onomatopées, fait exploser les couleurs, explore toutes les possibilités de sa palette graphique pour donner un cachet unique à ce récit futuristico-psychédélique (extrait). J'adore son dessin à la fois vif et détaillé, qui flirte parfois avec le cartoon. L'album est dédié à Jack Kirby. L'influence de Moebius est également manifeste. L'originalité est totale.
Tom King, Jorge Fornés & Dave Stewart : Danger Street (Urban Comics)
Starman, la Green Team, Lady Cop ne sont pas les personnages les plus célèbres de l'univers DC Comics. Tom King a pourtant voulu leur redonner de la visibilité dans cette histoire racontée par un casque (!) dans une prose médiévale. Il est question de super-héros qui provoquent une catastrophe, de gamins affichant une perversité sans limite et d'une policière ayant bien du mal à rétablir l'ordre. On croise Batman, Darkseid fait peser une menace sur l'avenir de la Terre. Une fois de plus, Tom King a écrit un récit foisonnant dans lequel chacun des nombreux protagonistes parvient à exister et faire entendre sa singularité. Le dessin réaliste de Jorge Fornés nous plonge au coeur de l'action tandis que Dave Stewart (déjà à l'oeuvre dans BRZRKR Bloodlines) fait montre de son talent de coloriste. Ces douze chapitres développés sur 376 pages (découvrez les premières planches) sont comme les épisodes d'une série addictive.
Tillie Walden : Walking Dead - Clementine tome 2 (Delcourt)
Clementine est l'héroïne d'un jeu vidéo adapté de la série Walking Dead. Accompagnée de Ricca et d'Olivia, elle tente de survivre dans un monde infesté de morts-vivants. Le trio débarque sur une petite île dont la communauté est dirigée par une ancienne médecin légiste. Une nouvelle vie commence, plus tranquille. Et pourtant, Clementine ne parvient pas à s'intégrer pleinement à ce groupe qui semble cacher un secret. Délicatesse du dessin, qui semble sorti du carnet d'une adolescente, délicatesse des sentiments... Tillie Walden nous fait partager l'intimité de trois jeunes femmes qui peinent à surmonter leurs traumatismes et exprimer leurs sentiments. L'horreur du quotidien n'empêchent pas l'amour et l'espoir de briller, comme les étoiles au sein de la nuit noire. Cette trilogie est décidément prenante.
Anderton